




Histoire
de la commune
Français Anglais Allemand
Le territoire est déjà occupé à l’époque des chasseurs cueilleurs. Traces d’occupation romaine, Mouchan se trouve sur l’axe Agen – Eauze (capitale de la Novempopulanie). Le nom de Mouchan vient d’un dignitaire romain Mucius qui avait une propriété sur l’emplacement actuel du village. Une première église a du être édifiée avant le 10ème siècle par des Bénédictins, les reliques de St Austrégésile assure la renommée de la communauté religieuse. En 1089, Mouchan est donné à l’Ordre de Cluny et devient un doyenné. L’église est entièrement remaniée, construction d’un cloître, de bâtiments conventuels dans le but d’accueillir des moines bénédictins mais aussi des pèlerins car Mouchan se situe sur le chemin de pèlerinage qui relie Le Puy en Velay à St Jacques de Compostelle (Via Podensis). Le Prieuré occupait le cœur actuel du village ce qui explique que l’église n’est pas en son centre. En 1264, Mouchan est placé sous la protection du prieur de St Orens d’Auch. | Le prieuré eut à souffrir les rapines pendant la guerre de Cent Ans. En 1569, les troupes protestantes investissent le prieuré, massacrent la population, détruisent le village et incendient l’église. Les moines ne se sentant plus en sécurité quittent Mouchan en 1572. Le village est reconstruit en utilisant les pierres du prieuré. Vers 1843, le père Jean Blain entame avec l'aide de la population, des travaux de restauration de l’église afin de la préserver. Le village se transforme sous la municipalité de Bernard Faget vers 1881 avec la construction de la mairie école ; du déplacement du cimetière de la place, de la création du lavoir fontaine, de l’allée des tilleuls. Pendant la 1ere guerre mondiale la commune va payer un lourd tribut avec 30 soldats morts au combat. L’église est classée aux Monuments Historiques en 1921. En octore 2021, la commune de Mouchan est officiellement engagée dans la démarche Cluny et les Sites clunisiens européens, candidature Patrimoine Mondial. |
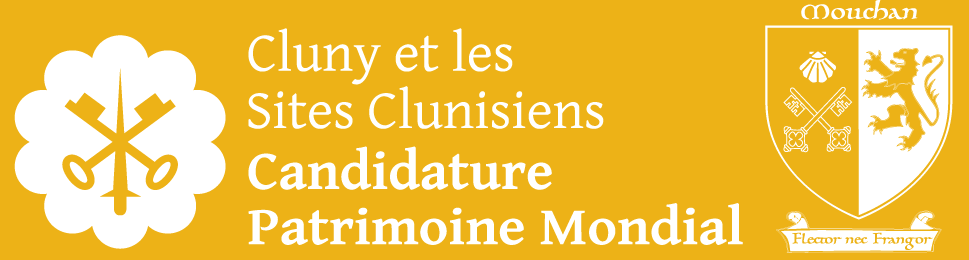
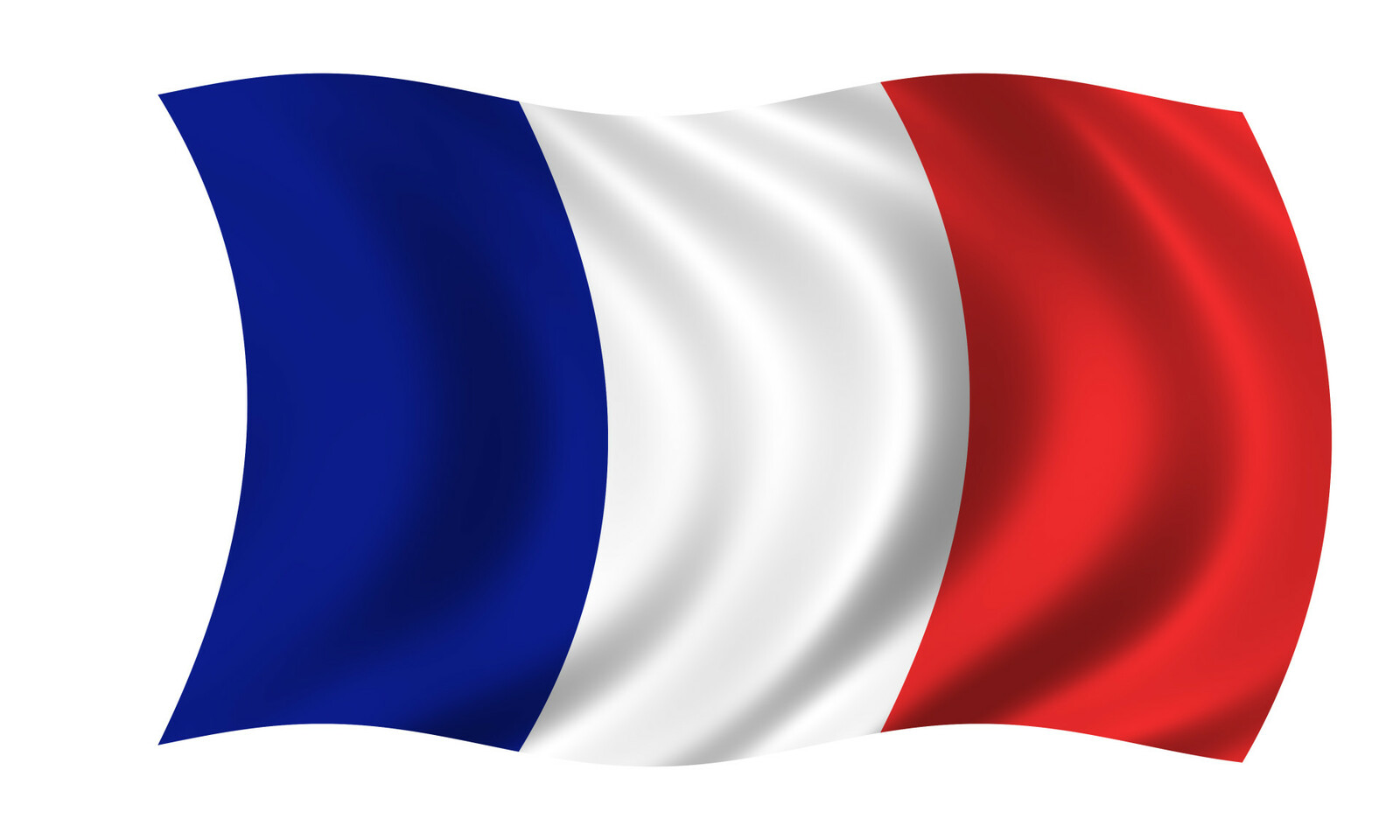
Histoire et visite
de l'Eglise Saint Austrégésile - Saint Pierre
I ENTREE PAR LA TOUR 1° Accueil extérieur La tour daterait de la fin X° siècle ou du début du XI° et appartiendrait à un réseau de fortifications (tour de guet), témoignage de la violence de l’époque féodale. A la fin du X° ou au début du XIe, des moines bénédictins prennent possession des lieux, construisent un prieuré et une petite église. En 1089, le prieuré est donné à l’Ordre de Cluny, alors ordre monastique le plus puissant de la Chrétienté et organisateur du pèlerinage de St Jacques de Compostelle dont Mouchan devient une halte de la Via Podensis (Voie du Puy). Les moines clunisiens rebâtissent l’église contre la tour et la recouvrent du même appareil (pierres de taille et maçonnerie). Le prieuré devient un doyenné. Depuis 2005, MOUCHAN est membre de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens. 2° Accueil intérieur Les moines ayant quitté le site le 2 juillet 1581 (certainement en raison des hostilités fratricides), l’église est réaménagée au XVII° siècle. Dès cette époque, on assiste à un profond rejet de l’art médiéval et ainsi les fresques du XIVe sont enduites, elles seront retrouvées en 1986 ; absence d’explications sur les motifs : on distingue 2 personnages, l’un barbu, l’autre portant une auréole, des chevaux, des arcades… LITRES ET SEIGNEURS : sur l’enduit, on aperçoit des litres, ce sont des bandes noires tracées au décès de chaque membre de la famille seigneuriale ; ces marques vont être effacées, notamment lors de la Révolution Française. Trois familles nobles se succèdent ; on ignore l’emplacement du château seigneurial, certainement sur le domaine de Lassalle (en gascon ce terme signifie château). La 1ère répertoriée est la famille BILHERES DE LAGRAULAS (village près de Vic-Fezensac) ; un de ses enfants des plus notoires est le Cardinal Jean III de Bilhères-Lagraulas, ambassadeur de France à Rome des rois Louis XI et Charles VIII. C’est lui qui commandera à Michel-Ange la célèbre Pietà du Vatican (Il meurt avant son achèvement). Puis, le fief passe à la famille DE BEZOLLES (village près de Valence S/ Baïse) qui vendront Mouchan à une grande famille de parlementaires, noblesse de robe originaire de Mauléon d’Armagnac, les MANIBAN seigneurs du BUSCA dans l’actuelle commune de MANSENCOME (Ils donneront le nom de leur terre à un quartier de TOULOUSE, le Busca qui existe toujours) ; Ils construisent un nouveau château à Mansencôme. C’est une famille très puissante ; d’ailleurs, une de leurs filles va être mariée au Premier Maître d’Hôtel du roi Louis XV et ainsi la Cour royale découvrira l’Armagnac. II INTERIEUR DE L’EGLISE 1° LE CHOEUR LA RESTAURATION daterait de 1846 ; typique du style Viollet-le-Duc car tous les joints sont soulignés (alliage de plomb) et les pierres sont recouvertes de ciment ; les pierres sont issues de la carrière de Ramounet. Hélas, à l’occasion de ces travaux, les fresques peintes dans le chœur ont été « nettoyées ». LES CHAPITEAUX qui forment les décors sont essentiellement à motifs végétaux ; pour la plupart, sculptés de feuilles d’acanthe, d’autres avec des rinceaux ornés de fleurs, de glands, de pommes de pin ; ces ornements sont sobres et courants. A noter : l’unique chapiteau (près de la sacristie) avec son tailloir décoré (pierre du dessus) et sa colonne dont la base est à motif torsadé ; on peut penser à un réemploi de chapiteau du cloître détruit après le départ des moines. Côté sud-est, on trouve deux chapiteaux figuratifs : le 1er représente des aigles emprisonnant des serpents de leurs serres, eux-mêmes mordant les ailes des oiseaux. Le second est orné sur trois côtés : le 1er montre une femme plongée dans un baquet ; deux thèses : soit les serpents lui mordent les seins et c’est le châtiment de la luxure, soit elle les allaite et la scène fait écho à la mythologie celtique, à savoir la déesse qui nourrit les forces terrestres. A noter : le serpent peut évoquer le mal mais avant le christianisme, le serpent symbolisait lesforces telluriques ; or, l’église est bâtie sur une ancienne villa romaine, elle-même édifiée au dessus de sources souterraines, de plus, il faut savoir que les lieux de cultes païens ont été récupérés par l’Eglise. Le 2ème figure un sonneur de cloches et le 3ème représente un sarcophage surmonté d’une croix. AUTRES DECORS : A noter qu’à l’époque, les compagnons travaillaient des deux côtés des Pyrénées. Au dessus, on aperçoit un cordon de billettes, ce motif à damiers est présent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; il est très caractéristique des églises situées sur le Chemin de Compostelle. Plus haut, on voit des demi sphères qui, elles aussi se répètent dans l’édifice. Il semblerait que ces ornements soient une stylisation des coquilles Saint-Jacques. Le chœur est aussi agrémenté d’un beau tabernacle du XVII° siècle, classé en 1908 ; typique du style baroque du sud de la France, doté de colonnes torsadées ; hélas, on remarque qu’à chaque extrémité, les niches sont vides puisque les 2 statuettes ont été dérobées dans les années 70. Autour, on voit reposant sur des socles, des statues en plâtre de saints, d’anges et têtes d’angelots datant du XIXe, certaines ont aussi été volées ! LES VITRAUX fabriqués à Condom datent du XIXe ; au centre, nous voyons le Saint- Patron de Mouchan, ST AUSTREGESILE ou OUSTRILLE. Noble de la Cour de Bourgogne puis Archevêque de Bourges au VIe ; il se rendit célèbre en soignant miraculeusement des aveugles, des paralytiques, des hystériques. D’après les archives du Diocèse d’Auch, ses reliques étaient conservées dans un buste reliquaire dans la première église avant 1060. Il faut savoir que le trafic de reliques était très fréquent au Moyen-âge ; les monastères n’hésitaient pas se dévaliser mutuellement car ces « trésors » étaient sources de profits et garantissaient la venue des pèlerins. D’ailleurs, Sainte-Foy de Conques a été volée à un monastère d’Agen ! Dans ce contexte, il n’y a donc rien d’étonnant à détenir celles d’un archevêque de Bourges à Mouchan. A noter : Bourges va devenir rapidement une métropole et son archevêque détient le titre de Primat d’Aquitaine ; il se peut que ses habitants aient voulu protéger les reliques de Saint Austrégésile de l’invasion viking en les transportant dans un endroit isolé tel que Mouchan. 2° LE TRANSEPT Sous l’action de Monsieur Duprat, LA CROISEE est l’élément majeur qui a permis de faire classer l’église Monument Historique en 1921. Il est le père de Madame Nicole Castaing, qui comme lui, a œuvré pour Mouchan ; jusqu’en 2005, elle a été la gardienne de ces lieux ; c’est elle, notamment, qui signala les fresques de la tour. On considère que cette croisée serait une des premières voûtes en ogive du sud de la France ; cependant, il manque la clé de voûte et les arêtes ne font que reposer sur les piliers ; elles ne participent pas à la poussée des forces. En regardant plus attentivement, on distingue plutôt un double plein cintre croisé ; c’est donc une ébauche d’ogive ; nous nous trouvons à la transition ROMAN/GOTHIQUE. De plus, les moines clunisiens qui chantaient beaucoup ont su par la hauteur de la nef profiter d’une très bonne acoustique. C’est pourquoi, encore de nos jours, des chorales se produisent et des concerts instrumentaux y sont organisés. Cette élévation annonce la construction des cathédrales gothiques un siècle plus tard (Saint-Denis 1140). On retrouve le même type de voûte à l’abbaye de Flaran qui appartenait aux cisterciens ; l’Ordre de Cîteaux était rival de Cluny. L’ANCIEN CLOCHER : au dessus de la voûte existait une tour servant de clocher ; cette tour a été détruite en 1569 au cours d’un incendie ordonné par Montgomery (Capitaine des Gardes Ecossaises à la Cour de France, c’est lui qui lors d’un tournoi chevaleresque fut à l’origine de la morts accidentelle du roi Henri II, il lui avait planté sa lance dans l’œil). Après cet événement, il se réfugia chez Jeanne d’Albret au château de Nérac (mère de Henri de Navarre, futur roi Henri IV), chef du Parti des Protestants. A Saint Puy, résidait Blaise de Montluc (surnommé « le bourreau du roi »), chef de l’armée catholique. Dans ce contexte, ces deux ennemis s’affrontent et perpétuent de nombreux massacres dans la région, c’est ainsi que Mouchan fut incendié par les troupes protestantes de Montgomery, le clocher et une partie de la nef s’écroulèrent. CHAPELLE DU TRANSEPT ET ABSIDIOLE : le transept forme deux chapelles ; celle au nord est dédiée à la Vierge Marie et celle au sud au Sacré-Cœur de Jésus. On peut admirer deux tableaux de l’Ecole Française du XVIII°siècle : « La Vierge écrasant le serpent » et « Saint-Pierre Apôtre » ; le 1er est du peintre Jean-Baptiste Smet, artiste flamand installé à Auch et renommé pour ses œuvres religieuses, le second rappelle que Saint Pierre est le Saint- Patron (avec St Paul) de l’Ordre de Cluny, d’où le deuxième vocable de l’église. Ces 2 toiles ont fait l’objet d’une restauration en 2007 et ont retrouvé leurs places initiales. Le tableau de la Vierge est accroché dans la chapelle nord et celui de l’apôtre sur le mur au fond de la nef. Le mur élevé au XIXe ferme l’absidiole nord qui, de fait, a été transformée en sacristie ; on peut voir des chapiteaux, notamment un assez énigmatique : des têtes de félins stylisés (chats ou lions) ? Dans le transept, on remarque un chapiteau figurant « Daniel dans la fosse aux lions », par ailleurs, on voit aussi des lions très réalistes sur un chapiteau situé entre la croisée et le chœur. 3° LA NEF On pense que la nef détruite au XVI° siècle fut remontée un siècle plus tard, il est notable qu’elle n’est pas proportionnelle par rapport au chœur et au transept. Le plan de l’édifice est aujourd’hui en croix grecque, alors qu’à l’origine il était bien en croix latine. De plus, les segments de piliers correspondraient à des arcs doubleaux, ce qui indique qu’autrefois, la nef comptait une seconde travée. Les archives de la restauration opérée au XIXe précisent que l’arcade de la voûte en berceau subsistait toujours avec ses chapiteaux, toutefois, à cette époque, la voûte fut refaite et l’arcade fut démolie. D’autre part, il faut savoir que jusqu’au XVIIe, l’entrée se situait côté nord (encore visible à l’extérieur); Puis, on ouvrit une autre entrée au sud, celle actuelle située sous le porche. A noter : la collection de vêtements liturgiques des XVIII° et XIX siècles. Au centre du mur, nous voyons une statue supposée être St Austrégésile (qui fait face au vitrail du chœur) ; la tradition dit qu’elle fut retrouvée dans les décombres d’une petite chapelle d’un hameau mouchanais détruite par les protestants ; elle fut l’objet de pèlerinages et longtemps très vénérée. Au dessus, le vitrail montre un Poilu mourant dans les bras de Marie et du Christ ; il s’agit de Maurice ROBERT (son nom est gravé sur la plaque de marbre en hommage aux soldats, Enfants de Mouchan morts lors de la Première Guerre mondiale). Sa mère, résidente au château du Tauzin (route de Condom), était très appréciée ; ce vitrail est un témoignage du désastre provoqué par ce terrible conflit. ART SULPICIEN : les statues sont typiques de cet art du XIXe, représentations du renouveau catholique ; l’Eglise a voulu réaffirmer la foi des populations éprouvée après 3 révolutions anticléricales (1789. 1830. 1848). On remarque Notre-Dame de Lourdes dont le culte se manifeste dès le Second Empire. De plus, 2 statues importantes localement trouvent leur place dans l’église : Ste Germaine de Pibrac reconnaissable à son tablier fleuri (un pèlerinage se déroule chaque 21 juin à Pibrac, commune près de Toulouse) ; petite bergère de la fin du XVIe maltraitée par sa belle-mère ; des guérisons dites miraculeuses auraient eu lieu de son vivant puis après sa mort, sa tombe fut saccagée à la Révolution, elle fut canonisée au XIXe. Jeanne d’Arc, nommée la Bienheureuse, cette statue date d’avant sa canonisation en 1920 ; son culte est lié au déploiement du patriotisme de la fin du XIXe. Elle est présente dans beaucoup d’églises gersoises car elle était surnommée « L’armagnacaise » bien qu’elle ne fût jamais venue dans la région ; c’est sa fidélité au roi Charles VII (qu’elle fit sacrer à Reims) qui lui vaut ce titre, d’autant qu’elle commanda aux Capitaines du roi qui luttèrent contre les anglais (maîtres de l’Aquitaine) et les bourguignons (leurs alliés) durant la Guerre de Cent Ans. A noter : Condom et Mézin étaient sous domination anglaise ; Mouchan fut incendié par les troupes du Prince Noir, fils aîné du roi d’Angleterre alors que Lectoure était ville seigneuriale des Comtes d’Armagnac (fidèles au roi de France) III EXTERIEUR DE L’EGLISE A noter : près du porche, la croix missionnaire de 1838, qui à l’origine se trouvait sur la place face à l’église fut déplacé à cet endroit d’après la tradition orale, pour permettre au premier camion d’un volailler du village de pouvoir manœuvrer plus au large (la direction assistée n’existait pas encore). 1° SUD-OUEST De ce côté, on remarque que la nef a été reconstruite au vu des différents appareils, également, on voit le contrefort du pilier intérieur. De plus, on distingue plus haut la base de l’ancien clocher ; dans les années 70, on trouva un sarcophage mérovingien d’un très jeune enfant (actuellement exposé à l’accueil) ; il se peut qu’il provienne de Gelleneuve (campagne de Mouchan), lieu d’une nécropole mérovingienne. Lors de ces fouilles, un magnifique chapiteau fut découvert puis envoyé en dépôt au musée de Lectoure, spécialiste des Antiquités ; hélas, l’objet s’est « volatilisé » de ses réserves. 2° OUEST Les moines de Cluny ont quitté Mouchan le 2 juillet 1581, époque où leur prestige était déjà amoindri ; Le doyenné dépendant de Saint-Orens d’Auch était une sauveté, à savoir une communauté regroupée sous la protection de l’Eglise (ce qui n’a pas empêché les incursions violentes). Après le départ des moines, les mouchanais ont reconstruit les parties endommagées l’église qui est devenue paroissiale mais les bâtiments monastiques ont servi pour construire les maisons ; il faut savoir que les moines avaient procédé de même avec les sites gallo-romains. Des bâtiments du doyenné, il ne demeure que le soubassement du moulin à eau (à la Bourdette), la tour féodale de La Salle et un pont roman traversant l’Osse. Mouchan, comme nombre de villes et villages, a en son sein des vestiges de différentes époques de l’Antiquité au XXe. 3° NORD-OUEST Des traces au sol évoquent le parvis et le cloître détruit ; jusqu’au XIXe, le cimetière se trouvait autour de l’édifice. L’ancienne porte paraît assez basse mais d’après les archives diocésaines, on entrait dans l’église en descendant quelques marches. Sur cette porte murée, on observe les billettes et le motif à corde, toujours ces mêmes caractéristiques des églises situées sur le Chemin de Compostelle. De plus, on remarque de chaque côté, deux croix identiques qui semblent être les croix de consécration. Par ailleurs, les cavités des murs sont des trous de boulin ; ils permettaient aux ouvriers de monter les échafaudages. Du côté du transept, tout le long de la corniche, on distingue des boules, des billettes et des modillons, dont un obscénat masculin. A noter : les obscénats ; scènes expressives très courantes au Moyen-âge (époque sans tabous) ; il faudra le Concile de Trente (fin du XVIe) pour que les catholiques surenchérissent sur le puritanisme des protestants et que ces représentations extérieures soient supprimées (les mentalités vont évoluer vers davantage de pudeur). 4° NORD D’autres modillons décorent la corniche : pommes de pin (probablement symbole de l’immortalité), tête de taureau, volute, trio de boulets (pas d’explications), boule gravée d’une Croix. Cette partie du bâtiment témoigne du travail des tâcherons ; les marques gravées que l’on aperçoit sont les « signatures » des tailleurs de pierre qui étaient payés à la tâche; certaines identiques se retrouvent à Flaran (abbaye édifiée une trentaine d’années plus tard) et à l'église St Sigismond de Larressingle. A noter : les marques se transmettaient de père en fils ou de maître artisan à apprenti. La corniche de l’absidiole offre d’autres modillons, notamment trois figurations assez surprenantes : un obscénat féminin, un chat à la tête complètement retournée, qui sourit, et tire la langue et dont les pattes s’accrochent à la génoise, un orant (homme en prière) ou un être humain ayant les bras croisés sur la poitrine. 5° CHEVET Du côté nord, on voit un 3ème obscénat : un couple enlacé Plus loin, on découvre la sculpture d’un ours à l’extrême-est. Cet emplacement n’est pas insignifiant car dans la culture celtique, l’ours incarne la royauté. A noter : la racine vocale « art » signifie « roi » (Roi ARTHUR) Afin d'affaiblir les cultes « païens », les chrétiens vont faire de l’ours un animal maléfique puis le remplacer par le lion (très présent dans l’héraldique) ; On remarque les serpents entourant les colonnettes de la baie centrale. Au terme de la visite, on constate que la tour d’accès a été surélevée pour servir de clocher.
|
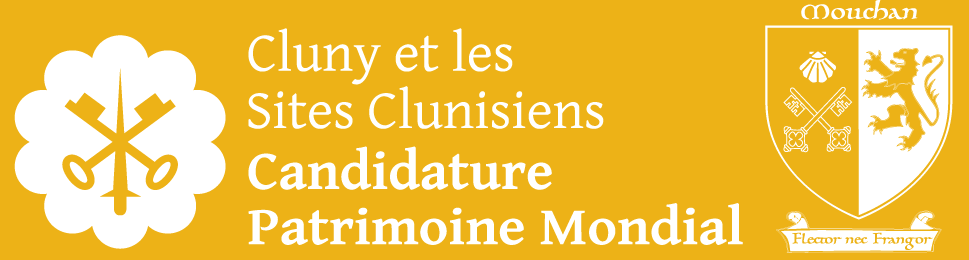

HISTORICAL
The origins of the name Mouchan are to be found in Gallo Roman times.
Maybe Muscius, a roman dignitary’s name that will be cut and shaped over the years by the Latin and Gascon languages. We thought have successively Muscius, Moyssano, Moishan and finally Mouchan.
Situated on the main road between Agen and Eauze to the river Osse, Mouchan enjoys a highly favored setting which explains the discovery of one half of a capital, a marble column, and a lot of Vth century coins with Honorius ‘head, which indicate the presence of a Gallo-Roman Villa.
The decline of Roman Empire was followed by the Barbarians invasions and the Gelleneuve Necropolis (private propriety) reveals knives and over objects which were used during this time.
The 10th century of return of « peace », allows the Benedictine monks to build on the gallo-roman remains, the Priory of Mouchan, dependent of famous Cluny Abbey in Burgundy: « Ad ecclesiam decanatus de Moyssahano, Cluniac. Ord Auxitam ». The Cluniac order is the most important in the Christian world in the Middle Ages. The Benedictine church, situated on the St Jacques de Compostelle trail, is absorbed by Cluny in 1089, thus the Priory becomes a Deanery.
Bit by bit, a village forms around the Priory, thus benefitting for its protection and this is known as a « sauveté ».
The church itself is dedicated to St Autrégésile, celebrated on May 20. This saint was already venerated in 1062 at the time of the consecration of the St Nicolas’ collegiate of Nogaro and Ste Marie’s cathedral of Auch, 60 years later.
However, the increase in numbers, both of monks and pilgrims, makes a further enlargement of the church necessary.
At the same time, the village takes on a more structured shape with the construction of walls and a moat.
In the 14th century, english soldiers under The Black Prince came from Mézin (Lot et Garonne) invades our village and part of it is destroyed.
From the 16th century, onwards the village is rebuilt, the wattle and daub walls being replaced by stone.
The village seems to be concentered essentially to the east side of the church.
The fortifications which had successfully resisted during « the Hundred Years War » are nonetheless unable to preserve Mouchan from the devastations of the Protestant Troops under Montgomery in July 1569 who badly damaged the church. The monks no longer felt safe left Mouchan in 1572. The village was rebuilt using the stones of the priory.
In 1650, the plague decimated ¾ of the population.
The 19th century is notable for the very useful work carried out inspired by Abbé Jean BLAIN, curate of Mouchan for 47 years. He undertook work to safeguard the church in 1842.
In 1881, the mayor Bernard FAGET gave Mouchan its current appearance, he built the town hall-school and moved the cemetery.
Two aristocratic families in Mouchan: The Bezolles in the 17th century and The Maniban in the 18th century.
And so, we have had one very famous man: in the 15th century, the Cardinal Jean III BILHERES LAGRAULAS, Archbishop of Lombez (Gers) and ambassador of Kings Louis XI and Charles VI.
THE VILLAGE
• The 18th century façade of a house probably belonged to a dignitary. The main entrance-door is surmounted by a segmented arch resting on pilasters with simple capitals.
The cornice outlined by a double Genoese breaks off just over the door.
• St Roch’s cross in stone: this saint who is reputed to heal sufferers of the plague, is always represented with his dog.
• The ruins of the roman bridge: this bridge which spans the river Osse, gave the Benedictine Community access to the mill, a good source of income for the church.
• The former presbytery in the style of Louis XV (1753)
THE PLAN OF THE CHURCH
The church, situated in the square, is built of limestone from quarries near the hamlet of Ramounet. A walk round the outside makes one aware of the originality of its plan, which is based on a Greek cross with a very short nave.
Viewed from the east face, you can see that the apse is flanked by an apsidiole to the north, whilst to the south there is a square tower of a “somewhat enigmatic appearance”. This tower built on arches can be traced back the 11th century.
It would seem to be older than the church itself, perhaps having a defensive purpose.
A turret staircase which was attached to it, gives access.
Furthermore, this turret shows several identifications brands, which enable workers to be paid.
The door gives access to the now defunct cloisters having been walled up, the main entrance to the church is on the southside of the building.
A small door, cut into the arch of the former arcades, gives access to the tower, the ground floor of which serves as an apsidiole. On this lower inside wall part of the fresco, dating back to the 14th century, was founded in 1986.
Inside the door, we proceed to the nave of the church. This the part which suffered most from the wars and is therefore the only area where reconstruction work has been carried out.
Made of only two bays the nave is covered by a bower.
Further forward we find ourselves at the intersection of the transept.
The north wing of the transept which has as a vaulted roof is ringed with billet cord.
This ring continues into the small apse where the décor is more elaborated.
There the capitals are carried in the form of animals and vegetation.
The apsidiole which is also the sacristy has adjoining window with the sanctuary (as at Valcabrère in Comminges)
The choir, shaped in semi-circles is divided into two floors by two cordons.
Into the lower part there are arcatures made by juxtaposed diamond-shaped stones resting on the capitals which have simple designs of leaves, interlacing stalks, floral designs, pinecones, lions, and eagles. One of these, however, seems very strange. It takes the form of three shapes: a sarcophagus, a bellringer and a woman how seem to be suckling two snakes.
In the upper part of the choir, three stained glass display in the 19th century made in Condom.
In the west wall of the transept, there is a spiral staircase which leads to a tower leading over the transept. The vault which is the most interesting feature of the church has been preserved. It is made of two ribs, without a keystone. Rectangular in section, these rest on fragile supports.
This 12th century architecture is an excellent example of the primitive style, here surprisingly well-preserved.
Here we see the beginnings of these attempt to construct the ribbed vault, has Roman Art developed into the Gothic style, as can be seen in the Cloister of Moissac as well.
The church as nevertheless undergone certain changes, specially of the area behind the altar, which has been raised. Some remarkable carvings-on this part of the church-can be seen from the outside.
Inside the church, you can see a wooden statue of Saint Austrégésile (the legend says that it was found by a workman at St Germain, a small hamlet, brought back in procession and that many miracles followed).
The church was listed at Historical Monuments in October 1921, the 27.
SAINT AUSTREGESILE
Born in 551, he studied the Holy Scriptures and then was send to the court of King of Burgundy. When it was suggested that he should marry, he replied: “If I had a good wife, I’d be afraid of loosing her and if I had a bad one, I’d rather do without”.
Feeling that he had vocation to the priesthood, he left the court and was consecrated, first as a subdeacon and then as priest, when he was nominated to the church of St Nizier in 590.
This period of his life was marked by several miracles.
As Bishop of Bourges in 612, he healed a woman who was paralyzed, a blind woman and a neurotic young girl.
He died on May 624 the 20, after 12 years as a bishop.
In Mouchan, people pray to St Autrégésile to intercede for them in cases of nervous disorders.
Pilgrims came from all over Armagnac and brought many gifts.
Donations were plentiful especially before the Revolution.
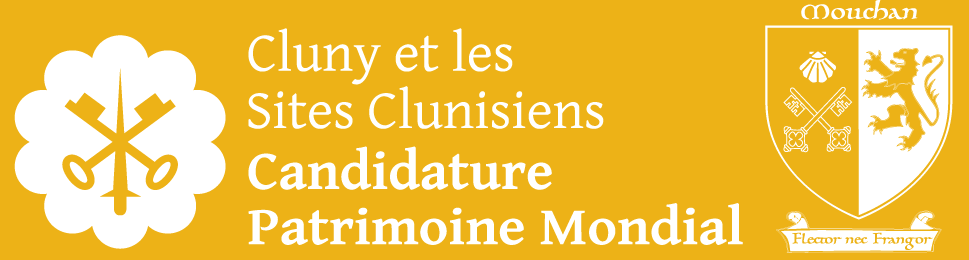

Geschichtlicher überblick
Die Herkunft des Namens MOUCHAN geht bis zur galloromanischen Epoche zurück. MUSCIUS, der Name eines Würdenträgers aus jener Zeit, wurde im Lauf des Jahres durch die lateinische und okzidentalische Sprache verwandelt und so ergab sich folglich: Muscius, Muscianus, Muscian und schließlich Mouchan.
Auf dem Handelsweg AGEN – EAUZE und nahe der OSSE war Mouchan immer gut gelegen.
So kam es, dass man nach und nach die Hälfte eines Kapitells entdeckte, eine Marmorsäule und einige Geldstücke von Honorius dem V, als Zeugnis einer ehemaligen galloromanischen Stadt.
Der Fall des Römischen Reiches ist von einem barbarischen Einbruch gefolgt. Der Friedhof von Gelleneuve bringt Waffen und andere Dinge, die während dieser Zeit nützlich waren, an das Tageslicht.
Das 10.Jahrhundert, oder die Rückkehr zum « Frieden », erlaubt es den benediktinischen Mönchen des Priorats von Mouchan auf den alten galloromanischen Resten zu bauen
Langsam formt sich ein Dorf rund um die Kirche, um von ihrem Schutz Nutzen zu tragen. Die Kirche ist dem heiligen SAINT AUSTREGESILE gewidmet.
Dieser Heilige wurde schon im Jahre 1062 bei der Weihung der Kirche von NOGARO verehrt, und ebenso bei der Weihung der Kathedrale von AUCH, 60 Jarre später.
Die benediktinische Kirche, die sich Aud dem Weg nach JACQUES DE COMPOSTELLE befindet, wird im Jahre 1089 durch CLUNY eingenommen. So wird das Priorat von MOUCHAN zu dem Dekan würde.
Die inzwischen immer größer gewordene Zahl von Mönchen und Pilgern verlangte den Bau einer wesentlich größeren Kirche. Zur gleichen Zeit wächst das Dorf und wird mit einer Mauer und einem Graben umgeben.
Im 14.Jahrhundert, beim Wiederaufbau des Dorfes, werden nach und nach der Lehm – und Strohfassaden durch Steinfassaden ersetzt. Das Dorf scheint sich vor allem im Osten der Kirche auszudehnen.
Drei Große Herrenhäuser werden in MOUCHAN gebaut, das LAGRAULAS im 15. Jahrhundert, das BEZOLLES und anschließend das MANIBAN (schloss Busca-Maniban).
Die Befestigungen, die trotz allem dem 100-jährigen Krieg standgehalten haben, können MOUCHAN nicht vor der Verwüstung durch protestantische Truppen von MONTGOMERY im Jahre 1589 beschützen.
Die Kirche wurde ebenfalls beschädigt.
Das Dorf
Das heutige Dorf ermöglicht uns Folgendes zu entdecken:
Die Fassade eines Hauses aus dem 18. Jahrhundert, welches wahrscheinlich einem Würdenträger gehörte. Die Eingangstür ist von einem Torbogen übergeben und ruht auf einfachen Wandpfeilern. Das Gesims ist im Bereich der Tür unterbrochen.
Die Reste der Gräben, die damals die Stadt schützten.
Das Steinkreuz von SAINT ROCH (dieser Heilige, der die Pestkranken heilen konnte, wird immer in Begleitung seines Hundes dargestellt, der ihm das Leben gerettet hatte). Am heiligen SAINT ROCH Tag kamen die Bauern mit ihrem Vieh, um es hier segnen zu lassen.
Die Ruinen einer romanischen Brücke. Diese Brücke überquerte die Osse und so konnten die benediktinischen Mönche die Mühle erreichen, die eine große Einkommensquelle für sie war.
Das Rathaus aus dem 19. Jahrhundert gehört zu den damals verwirklichten städtebaulichen Arbeiten.
Das alte Pfarrhaus im Stil von Louis dem XV (1753).
Und der Springbrunnen aus dem 19. Jahrhundert.
Plan der Kirche
Auf dem Dorfplatz befindet sich die aus Kalkstein gebaute Kirche. Dieser Kalkstein kommt aus dem Steinbruch nahe der « HAMEAU DE RAMOUNET ». Bei einem Rundgang um die Kirche fällt sofort ihr eigenartiger Grundriß ins Auge.
Der Grundriß ist ein griechisches Kreuz mit einem sehr kurzen Schiff.
Auf der Ostseite des Gebäudes sehen wir die Chorkapelle, während sich auf der Südseite ein seltsamer rechteckiger Turm befindet.
Dieser Turm stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist auf gemauerten Rundbogen gebaut.
Es scheint, als stand er schon vor der Kirche; wahrscheinlich aus Verteidigungsgründen. Ein Treppentürmchen, welches daran anschließt, erlaubt ihn zu besteigen. In diesem Turm finden wir heute noch die Zeichen der damaligen Steinmetze gesellen an den einzelnen Steinen. Diese Zeichen halfen die Arbeiter zu bezahlen.
Die Tür, welche zum Kloster führte, ist heute zugemauert. Der sehr schöne Kircheneingang befindet sich im Süden. Ein Kreuz auf der linken Seite des Portals weist auf die Gastfreundlichkeit für Pilger hin. Eine kleine Tür, in die alten betreten Rundbögen gebrochen, läßt uns den Turm betreten, wo das Erdgeschoß als Chorkapelle diente.
Auf seiner Innenseite finden wir Teile einer Freske, die 1986 entdeckt wurde. Diese Freske stammt aus dem 14. Jahrhundert.
Wenn wir durch die Tür in die Kirche treten, stehen wir im Schiff der Kirche. Dieser Teil hat am meisten unter den kriegen gelitten und ist demnach der einzige nachgebaute Teil.
Bestehend aus nur zwei Gewölbegängen, ist das Schiff von einem Gewölbebogen überdeckt.
Etwas weiter vorne befinden wir uns im Querschiff.
Im Nord an dem Querschiff, von einem Gewölbe übergeben, finden wir eine rundumgehende Dekoration. Dies führt uns in eine geschlossene Chorkapelle mit einem reichen Dekor. Hier sind die Sauen von bemerkenswerten tierischen und pflanzlichen Skulpturen verziert. Die Chorkapelle, die den Platz der Sakristei einnimmt, öffnet sich zum Altarraum durch eines seiner Fenster (wie in VALCABRERE EN COMMINGES).
Der Chor endet im Halbkreis und ist durch zwei Reihen in zwei Stockwerke unterteilt. Im unteren Teil sehen wir zehn verzierte Bogenwerke, die auf Pfeilern ruhen. Die Pfeiler sind von schönen Motiven verziert: Blätter, verflochtene Stiele, Blumen, Kiefernzapfen, Löwen, Adlern …
Ein Pfeiler ist jedoch nicht wie die anderen. Er zeigt uns drei Bilder: einen Sarkophag, einen Glöckner und eine Frau die scheinbar zwei Schlangen ernährt.
Im oberen Teil des Chores erhellen drei Öffnungen die in CONDOM hergestellten Kirchenfenster aus dem 19. Jahrhundert.
Zwei bunte Fenstermotive umgeben ein Fenstermotiv des heiligen SAINT AUSTREGESILLE.
An der Westmauer des Kirchenschiffes befindet sich eine weitere Treppe, die auf einen Turm über dem Kirchenkreuz führt. Dem Turm besteht heute nicht mehr, es sind nur noch die Wölbungen erhalten, die zum interessantesten Teil der Kirche gehören. Es handelt sich um ein Gewölbe, das zusammengefügt ist aus zwei Spitzbögen und ohne exakten Plan gebaut ist. Ihre rechteckige Form ruht auf nur sehr schwachen Trägern.
Diese Architektur aus dem 12. Jahrhundert zeugt von einem sehr primitiven Stil, der erstaunlich gut erhalten ist. Hier werden die ersten Versuche zu Spitzbogengewölben sichtbar. Die gotische Baukunst löst die romanische Baukunst ab, was besiegt die Romanische, was man auch gut in MOISSAC beobachten kann.
Die Kirche hat jedenfalls einige Veränderungen miterlebt. Die Apsis wurde im Laufe der Jahre erhöht. An der Außenseite der Kirche sehen wir die einfache Apsis dargestellt.
Im Inneren der Kirche befindet sich eine bemerkenswerte Sammlung von priesterlichen Kleidungen, eine hölzerne vergoldete Altarwand aus dem 17. Jahrhundert, geschätzt im Jahre 1908, ein achteckiges Taufbecken aus Stein und eine Holzstatur vom heiligen SAINT AUSTREGESILLE aus dem 16. Jahrhundert. Die Legende erzählt, dass sie von einem pflügenden Bauern bei in einem großen Prozessionszug nach MOUCHAN gebracht wurde. Es wird erzählt, dass daraufhin mehrere Wunder stattgefunden hätten.
Die Kirche wurde am 27 Oktober 1921 eingeschätzt und eingeordnet.